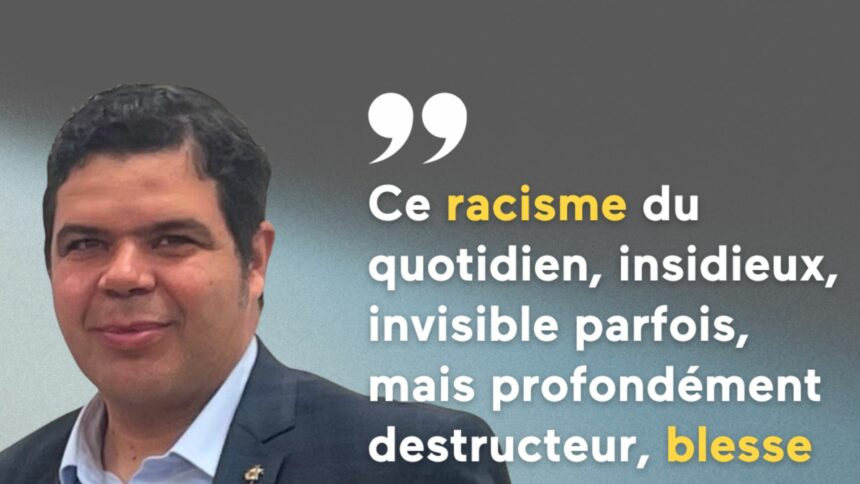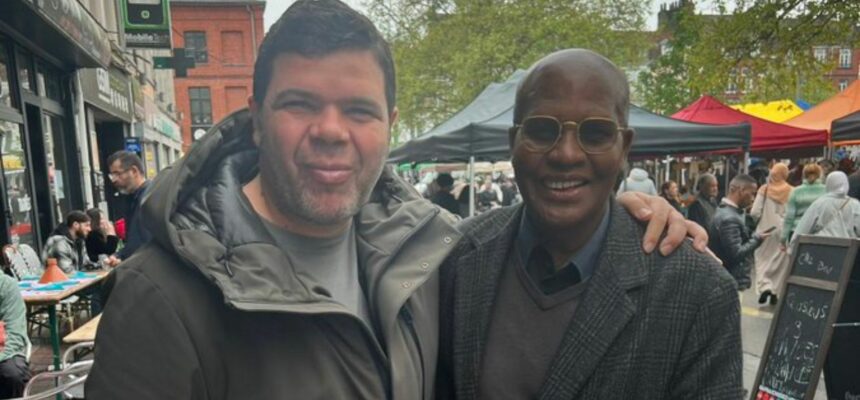Conseil municipal du 28 avril 2025
25/230 Plan territorial 2025-2026 de lutte contre le racisme, l’antisémitisme et les discriminations liées aux origines.
Monsieur Le maire, chers collègues,
Avant de commencer, je veux prendre un instant.
À La Grand-Combe, dans une mosquée, un homme s’est agenouillé. Il priait.
Il murmurait à Dieu ce que tous les cœurs blessés murmurent : que la paix revienne sur la Terre, que la haine quitte les âmes, que la douleur s’efface.
Il priait pour la vie. Et c’est la mort qui est venue le frapper.
Aboubakar n’a pas été tué par hasard. Il a été tué parce qu’il était lui. Parce qu’il priait. Parce que la haine ose frapper jusque dans la prière.
Ce crime n’est pas seulement un meurtre. C’est une profanation. Une blessure ouverte dans le cœur de notre République.
Tant que le racisme tuera, la République saignera.
Ce drame n’est pas seulement un meurtre, il est le rappel brutal que la haine commence souvent bien avant le crime.
Dans mille gestes invisibles.
Dans mille blessures ordinaires.
C’est ce fil-là, ce fil invisible du racisme quotidien, que je veux saisir ce soir, en mémoire d’Aboubakar et de tant d’autres.
Car il y a dans une vie des moments qu’on n’oublie pas.
Il y a dans une vie des moments qu’on n’oublie pas. Un jeune étudiant qu’on empêche d’entrer dans un bar pour une raison qu’on ne dit pas mais que tout le monde comprend. Une mère qu’on contrôle plus souvent qu’une autre dans les transports. Un garçon à qui l’on demande encore d’où il vient, alors qu’il est né ici, qu’il vit ici, qu’il appartient pleinement à notre République.
Ces scènes ne sont pas rares. Elles sont ordinaires. Et c’est bien cela, le problème. Ce racisme du quotidien, insidieux, invisible parfois, mais profondément destructeur, blesse en silence et use la promesse républicaine.
Alors oui, je me réjouis que notre Conseil débatte aujourd’hui d’un plan de lutte contre le racisme, l’antisémitisme et les discriminations. C’est une étape nécessaire. Un signal attendu. Il fallait que cela existe.
Peut-être ce plan vient-il aussi, en partie, en écho à certaines interpellations notamment celle que j’ai exprimées ici même dès décembre dernier. Si c’est le cas, alors c’est la preuve que le débat démocratique peut encore éveiller la décision politique, et c’est tant mieux.
Mais il faut aussi regarder les choses avec lucidité : ce plan arrive tard, à quelques mois de la fin du mandat. Et il arrive avec des moyens très limités : 20 000 euros, pour Lille, Lomme et Hellemmes. Une somme modeste face à un enjeu immense.
Avec mes collègues FRL je le voterai. Par fidélité à mes engagements. Par respect pour celles et ceux qui vivent ces discriminations et attendent de nous autre chose que des déclarations. Mais je le voterai aussi avec vigilance. Car ce texte, s’il pose un cadre, reste fragile : il manque d’indicateurs, de calendriers, de méthodes. Il appelle une suite. Il appelle de l’ambition.
Je veux saluer, malgré tout, le changement de méthode. Après nos remarques en commission préparatoire, le dialogue avec les acteurs a été amorcé, et l’écoute s’est faite plus attentive. C’est un premier pas. Un pas qu’il faudra transformer en mouvement.
Je souhaite aussi dire un mot sur les mots.
L’expression “discriminations liées à l’origine” revient souvent. Elle paraît neutre, presque administrative. Mais le racisme, lui, ne vérifie pas l’origine. Il vise un prénom, une voix, un visage. Il frappe à l’aveugle, nourri par les stéréotypes, pas par les faits. Alors soyons justes dans nos termes. Car mal nommer, c’est déjà mal répondre.
Et puis, il y a les mots dits sans malice, mais qui blessent quand même. Les petites phrases. Les soupirs. Les silences. Tout ce qui, sous couvert d’habitude, perpétue l’exclusion.
Quand certains médias amplifient la haine, quand certains responsables politiques désignent l’étranger comme coupable, et quand certains journalistes dits « spécialistes » travestissent la réalité en clichés, alors ce n’est pas seulement la parole qui se défigure : c’est notre démocratie qui se fissure.
La parole est comme l’eau : une fois versée, on ne la ramasse plus. Soyons donc attentifs à ce que nous disons, et à ce que nous laissons dire.
Notre ville a déjà su répondre à la haine : lors de la fermeture du bar identitaire La Citadelle, lors de la venue d’un candidat d’extrême droite, c’est ensemble que nous avons su dire non. Cet héritage nous oblige à continuer d’agir, pas seulement de réagir.
Alors oui, ce plan est un point de départ. Il ne peut pas être un aboutissement. Il appelle une stratégie. Des moyens. Une volonté qui dépasse les cycles politiques.
Et pour conclure — je veux le dire avec simplicité.
J’ai 51 ans. Et comme beaucoup d’hommes et de femmes issus de la diversité, j’ai connu des moments de mise à l’écart, des regards qui blessent, des mots qui marquent.
Je me souviens notamment de mon tout premier entretien d’embauche.
Il s’était bien déroulé : le recruteur avait accepté de m’embaucher.
Mais avant de finaliser, il m’a demandé de changer de prénom, estimant que « Ali » ferait « trop arabe ».
Ce n’était pas une simple suggestion : c’était une injonction raciste, une tentative de vouloir gommer ce que j’étais, mon histoire, mon identité.
Je l’ai refusée avec vigueur. Parce qu’on ne négocie pas qui l’on est. Parce qu’aucune fonction, aucun emploi, aucun statut ne devrait exiger de renier sa propre existence pour être accepté.
Avec le temps, on pense que ça passera.
Qu’avec l’âge, avec les responsabilités, on y échappera.
Mais non. Elles reviennent.
Parfois plus discrètes, parfois plus sournoises, mais toujours là.
Alors non, je ne suis pas venu ici faire un reproche.
Je suis venu dire que ce plan, même imparfait, même tardif, il est nécessaire.
Et qu’il ne doit pas être un geste isolé.
Je suis venu rappeler qu’il n’y a pas d’âge pour être blessé.
Qu’il n’y a pas de fonction qui protège vraiment.Que ce combat-là, contre le racisme ,l’antisemitisme et les discriminations, traverse les générations.
Et qu’il doit nous rassembler.
Parce qu’à la fin, ce que nous demandons, ce n’est pas un privilège.
C’est juste le droit de vivre dignement.
D’être regardés pour ce que nous sommes.
Rien de plus.
Et c’est cela, au fond, qui donne tout son sens à notre engagement commun.
Je vous remercie.